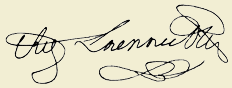Laennec avait pour grand-oncle, nous apprennent J. CORNOU
et P.R GIOT dans leur ouvrage "Origine et Histoire des Bigoudens"
Dom MAURICE de BEAUBOIS auteur d'"Une histoire de la Bretagne",
qui avait pour ascendante immédiate Urbanne CORENTINE LE GOARZE
DE PENISQUIN, en Plonéour.
Par sa mère, Michelle GUESDON, il était apparenté à Mme DE POMPERY,
la "Sévigné cornouaillaise", née Anne-Marie AUDOUIN du COSQUER,
qui tenait de son père quelques propriétés dans la région de Pont-L'Abbé
où elle viendra chercher refuge pendant la période révolutionnaire
(en particulier, la propriété du SEQUER, à la sortie de Pont-L'Abbé).
Son mariage tardif - il avait 43 ans - le rapprocha également du
pays Bigouden. Le 16 décembre 1824, il épousait Jacquette GUICHARD,
veuve ARGOU, qui était quelque peu sa parente ainsi que celle de
Mme de POMPERY chez qui il l'avait rencontrée. Elle était la fille
de Joseph GUICHARD, négociant d'origine marseillaise et d'une dame
GUEGUEN, parente d'Anne-Marie AUDOUIN ; son grand-père, Tugdual
CORIOU, était "constructeur de vaisseaux marchands".
Après le décès de Mme de POMPERY qu'elle avait suivie dès 1805 dans
sa propriété de Couvrelles, dans l'Aisne, elle vint à Paris, en
1822, diriger le ménage de son "cousin" Théophile. La maison du
grand-père Tugdual CORIOU, vendue au début du XIX° Siècle pour désintéresser
les créanciers de la famille ARGOU, est encore visible à Pont-L'Abbé,
à l'angle des rues Lamartine et Roger-Signor.
Les relations amicales, enfin, permirent aussi au Docteur Laennec
de retrouver le pays bigouden lorsqu'il venait se refaire une santé
en Bretagne après les fatigues de sa vie parisienne. Il séjourna
à plusieurs reprises au Manoir De La Villeneuve, en Saint-Jean,
où résidait son ami, M. de SAINT-ALOUARN.
Le Manoir de La Villeneuve lui fournit un pied-à-terre commode pour
surveiller la construction de son Manoir de Kerlouarnec, en Ploaré
ainsi que les travaux d'amélioration qu'il projetait pour les fermes
qu'il possédait dans le canton. Car s'il est une trace bien visible
de l'action du Docteur Laennec à Pont-L'Abbé, c'est bien cette digue
qui porte encore son nom, construite pour créer un polder sur la
palud (ou palue) du Cosquer. L'histoire et les circonstances en
ont été plus d'une fois contées. Elles méritent d'être rappelées.
Le 20 Août 1814, Laennec retrouve Quimper et sa région. Il y a déjà
une quinzaine d'années qu'il exerce à Paris. Il vient se ressourcer
au pays, se refaire une santé toujours fragile, d'autant plus que
ses projets professionnels marquent le pas. La grande découverte
qui le rendra illustre n'a pas encore eu lieu. Il a connu des moments
forts pénibles en raison des difficultés familiales dues aux "inconséquences
et déportements" de M. Théophile - Marie Laennec père qui, aidé
en cela par sa seconde épouse, a puisé sans compter dans les revenus
de ses enfants qu'il a confondus avec les siens. Le conflit se réglera
au tribunal, et l'on verra, ce 28 août 1809, le père et le fils
(il s'agit de MICHAUD qui agit au nom des enfants Laennec) plaider
l'un contre l'autre. Le père devra se résigner à accepter une transaction,
et, le 12 Octobre 1809, il se reconnaît débiteur d'une somme de
30 000 F seulement, mais il fait cession de tous ses biens à ses
enfants. MICHAUD, le fils cadet, dont la santé n'était guère florissante
avant cette triste affaire, décédera peu après, dans la nuit du
9 au 10 janvier 1810.
C'est ce qui permet de comprendre que Théophile Hyacinthe, qui n'avait
guère pour l'instant de revenus suffisants, soit devenu propriétaire
de plusieurs domaines épars dans le Sud Finistère. Si l'hôtel patrimonial
que possédait la famille à Quimper a dû être vendu, le domaine de
Kerlouarnec en Ploaré ainsi que les fermes situées dans les environs
de Pont-L'Abbé ont pu être conservés.
Le séjour de Laennec à Quimper en cette fin d'été 1814 comporte
un autre objectif : il s'agit pour lui de faire le tour du propriétaire
: d'abord le Manoir de Kerlouarnec, en Plouaré, son "cher manoir",
acquisition du grand père au siècle précédent. Il va découvrir une
propriété en fort mauvais état qu'il va s'employer à relever. Une
fois prises les premières mesures conservatoires, il se rend à Pont-L'Abbé
: c'est tout près de la capitale bigoudène que se trouvent les fermes
dont il a hérité, suite à la renonciation contrainte et forcée de
son père. Hébergé par son parent et ami, M. de SAINT-ALOUARN, en
son Manoir de la VILLENEUVE en Plomeur, il s'en va, chaque matin,
visiter ses fermes éparses dans le canton et faire la connaissance
de ses fermiers (à Saint-Jean, Plomeur, Lambour, Combrit...). Dans
le secteur de la palue du Cosquer (anse de Pouldon), Laennec possède
deux fermes : Kerguelen - Kerseoc'h au Nord et Ty Glas, Ty Guen,
Kerbenes au Sud, entre les deux, la ferme de Lande-Vallée qui est
à vendre et qu'il projette aussitôt d'acquérir. Il est, dès cette
époque, très préoccupé par ses propriétés qu'il s'emploie à réparer,
améliorer et arrondir, car il en attend des revenus qui lui permettraient
de prendre une retraite prématurée, l'air de la grande ville lui
convenant médiocrement. Dans ses archives on retrouvera un cahier
de vingt pages in-quarto concernant ses projets d'amélioration du
Manoir de Kerlouarnec où il entend bien s'installer, ainsi qu'un
registre de deux cents pages où sont consignées ses "Observations
sur les cultures, plantations et édifices considérés comme objet
de décoration et d'utilité" rédigées au cours de 1815, fruit de
ses observations personnelles comme de celles de l'oncle Guillaume
ou de ses amis.
Pour le moment, ces projets de retraite n'allaient pas aboutir.
Les années 1815 à 1818 seront, pour le médecin, des années décisives
: malgré la renonciation à publier son grand ouvrage, le "Traité
d'Anatomie Pathologique" laissé à l'abandon depuis 1809 ; malgré
la mort le 11 mai 1816 de son confrère et ami, le Docteur Pierre
BAYLE, le sort va se montrer favorable à Laennec, à la suite de
sa nomination officielle à l'hôpital Necker : de cette période date
l'invention du premier stéthoscope, période d'activité intense pendant
laquelle, avec l'aide de son cousin Ambroise Laennec et de quelques
fidèles, il s'emploie à mettre au point sa découverte. Cela n'ira
pas sans heurter la susceptibilité de bien des confrères en place.
La fatigue résultant de cette intense activité intellectuelle et
professionnelle lui fait à nouveau ressentir le besoin d'aller se
reposer. Vers le 7 août 1818, il se met en route pour Quimper. Il
doit visiter ses nouvelles fermes de Lande-Vallée et du Cosquer,
acquises depuis le précédent voyage. L'idée lui est également venue
d'assécher la Palue du Cosquer pour gagner de nouvelles terres destinées
à l'élevage, dans l'espoir d'améliorer son revenu. Il est vrai qu'à
l'époque, la mode était aux polders. Les deux petites fermes de
Rosveign et de Troliguer étaient à vendre : après analyse des titres
de propriété en sa possession et études des lieux, il en arrive
à la conclusion que cette palue n'est point un "lais de mer". Aussi
prend-il la décision d'acheter ces deux fermes. Il prépare des plans
dans la perspective de gagner 25 ha environ sur la mer et d'augmenter
son revenu de 1 200 livres pour pouvoir vivre de ses rentes.
Son biographe, Alfred ROUXEAU, déclare : "Il avait vu juste, et
ses héritiers recueillirent les fruits de son heureuse initiative".
Pourtant, notre "bon docteur" n'allait guère profiter de cette belle
idée mais, bien au contraire, y laisser ses dernières forces.
Que diable aussi allait-il faire dans cette vasière ?
Car il avait tout prévu, sauf la méchanceté des hommes et l'incohérence
malfaisante de l'Administration.
Le séjour de Laennec dans la région de Quimper en cette fin d'année
1819 sera marqué par deux décisions importantes : réfection et agrandissement
du Manoir de Kerlouarnec (indispensable pour pouvoir y résider)
; mise en route du projet d'assèchement de la Palue du Cosquer.
Laennec se fait architecte et ingénieur des Ponts et Chaussées pour
en dresser les plans : deux digues sont prévues, qui prendront appui
sur l'îlot dit Enez Banal, au milieu du Goulet, dispositif complété
par un aqueduc avec écluse et clapet automatique, ainsi que par
des travaux d'irrigation. Ces plans reçoivent l'approbation de l'ingénieur
en Chef du Finistère. Ce faisant, Laennec se met sur le dos une
lourde charge financière. Mais le plus pénible était encore à venir.
Les travaux de construction de la 1ère digue (de Troliguer jusqu'à
l'îlot) avaient commencé en 1820 : achevés en 1821, les résultats
ne furent pas à la hauteur. La négligence des fermiers avait entraîné
l'écroulement des clôtures de la palud en plusieurs endroits : l'accès
en redevenait banal.
L'opposition la plus résolue viendra d'un confrère,
le Docteur Alain BOHAN, chirurgien de la marine - on n'est jamais
si bien trahi que par les siens - et qui possédait en plein milieu
des terres acquises par Laennec un pré de quelques hectares. Il n'aura
de cesse de contester à Laennec ses droits de propriété sur la palue
du Cosquer.
Les travaux de construction des digues seront terminés
en 1825 ; mais les derniers mois qu'il reste à Laennec seront assombris
par les démarches qu'il entreprendra pour faire expertiser et authentifier
ses titres de propriété.
Une première intervention du Ministre Villèle tranchera en sa faveur
et sera immédiatement suivie d'une nouvelle réclamation de l'irascible
et funeste voisin, appuyée sur des témoignages et suscitant une enquête
des Domaines : le ministre entérine sa 1ère décision.
Laennec, voulant
prouver sa bonne foi, demande une 3ème enquête pour lever toute ambiguïté.
L'enquête traîna en longueur. Entre-temps, son état de santé s'était
aggravé; il avait rédigé son testament.
Le 16 juin 1826, il reçut de mauvaises nouvelles de son dossier.
Il devait décéder un mois plus tard, le 13 août 1826 à l'âge de
45 ans, miné comme son frère MICHAUD par une mauvaise santé (hérédité
maternelle) et par les tracas procéduriers suscités, non pas cette
fois-ci par son père, mais par un fâcheux voisin. La digue, témoin
des espoirs et des désillusions de son auteur a subsisté jusqu'à
nos jours, ainsi que les arbres semés dans les garennes de Rosveign
et Troliguer, sans préparation spéciale du terrain, et qu'il aura
eu la satisfaction de voir lever et croître, au grand dam des voisins
moqueurs qui brocardaient les méthodes du "parisien", qui finalement
n'était pas moins écologiste avant la lettre qu'un.
|